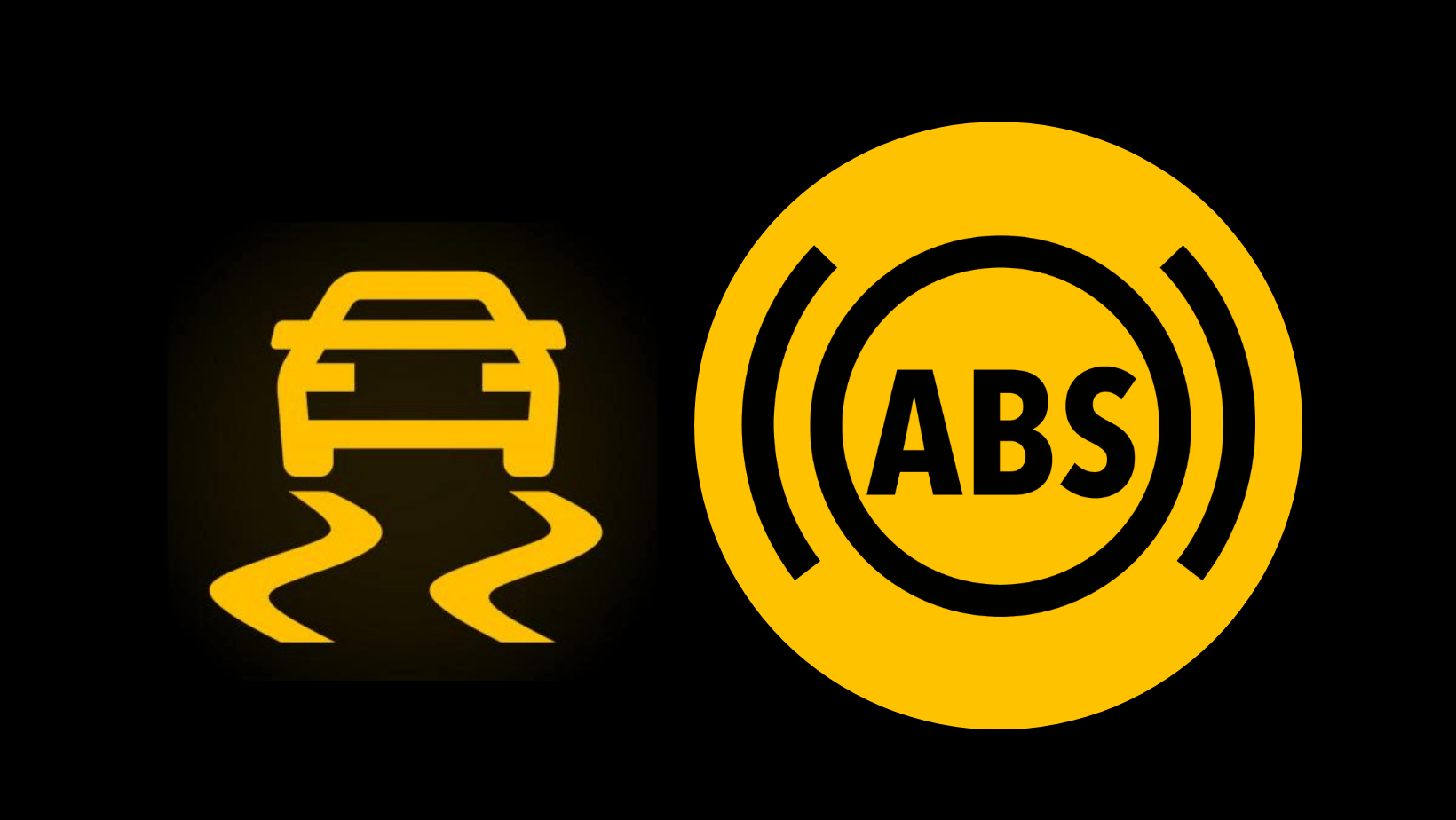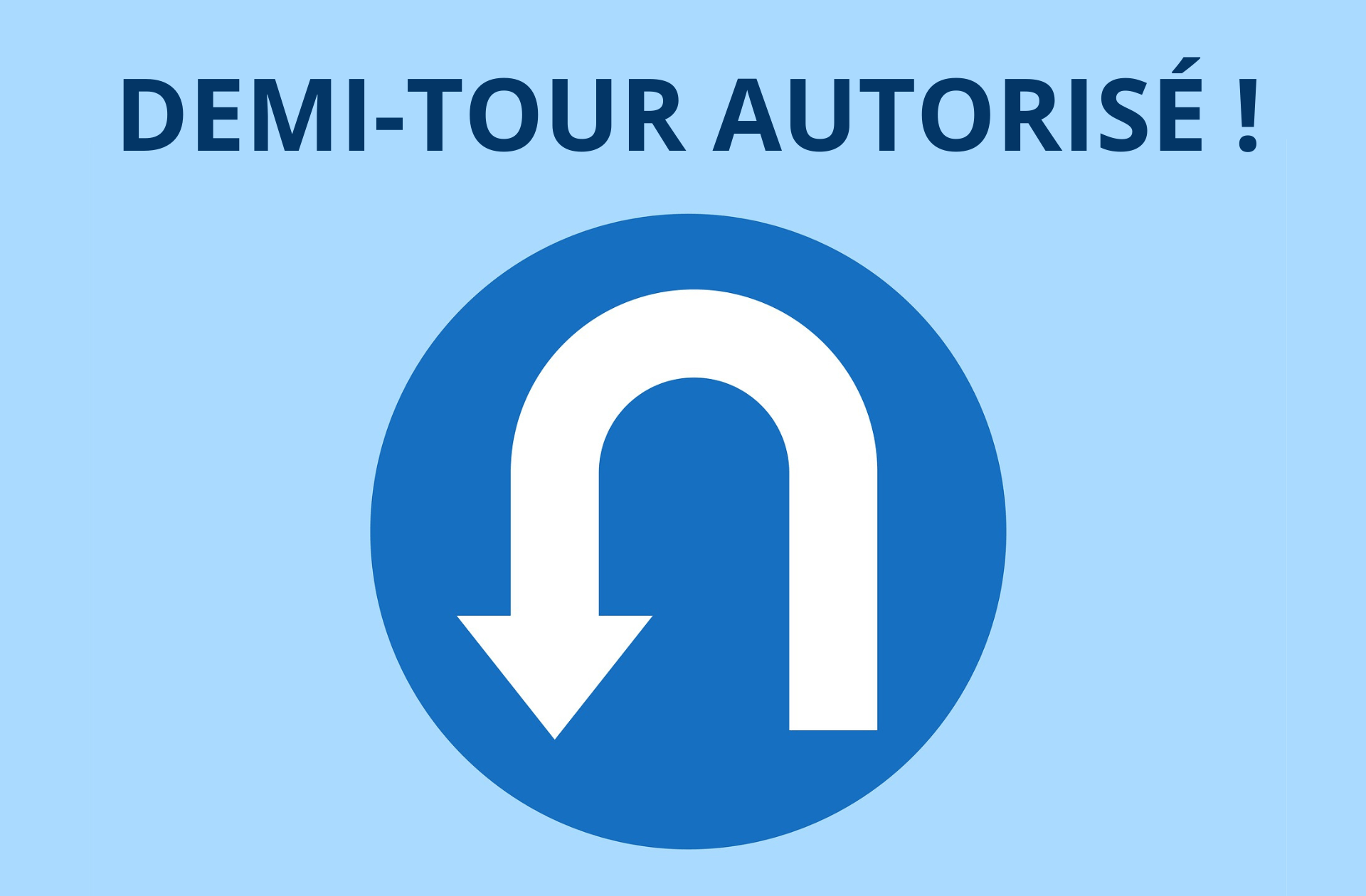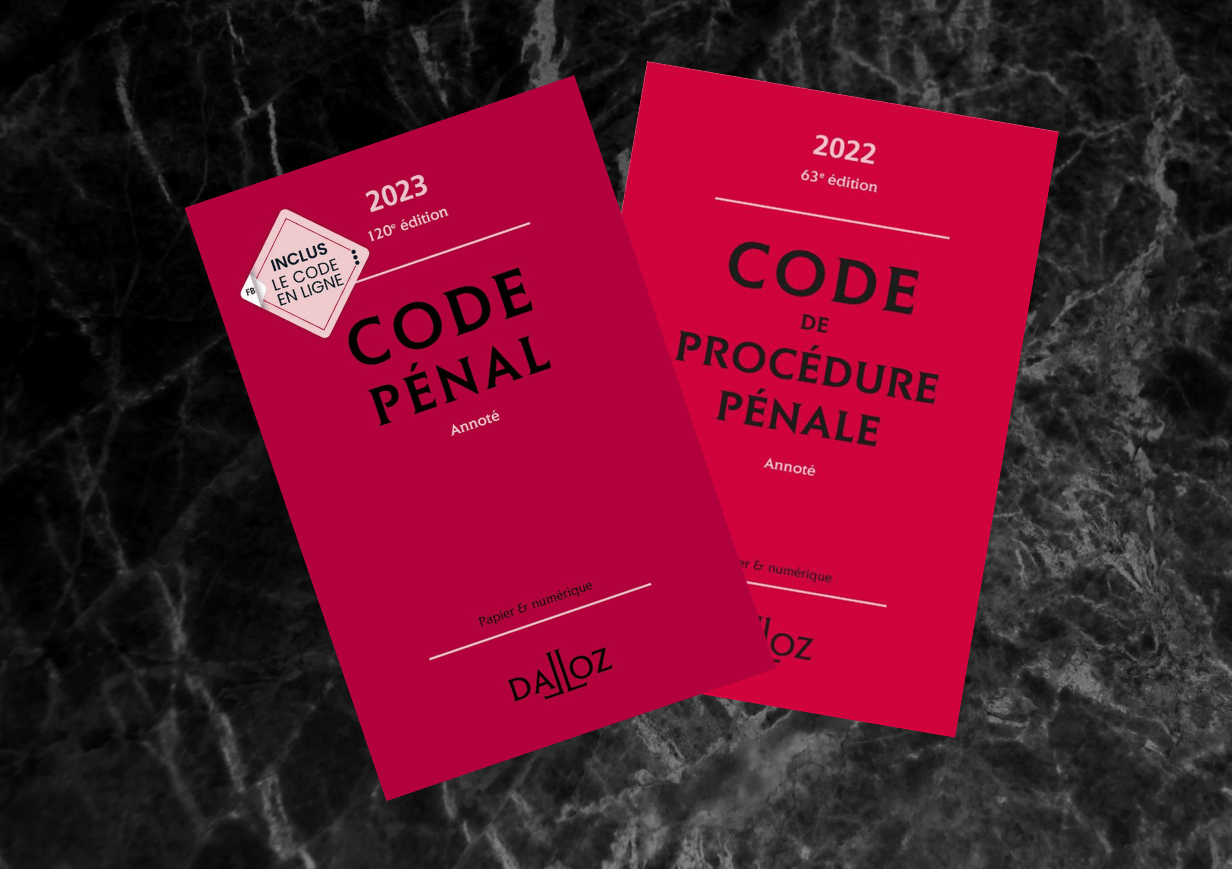En principe, le sous-locataire d’un bail commercial qui exploite dans les lieux loués un fonds de commerce doit pouvoir bénéficier du droit au renouvellement direct ou, en cas de refus, à une indemnité d’éviction.

Cela suppose que ce droit au renouvellement ou à l’indemnité d’éviction puisse s’exercer tant à l’égard du locataire principal que vis-à-vis du propriétaire.
Lorsque le droit au renouvellement s’exerce vis-à-vis du propriétaire, on parle du droit direct au renouvellement, lequel permet au sous-locataire de devenir locataire principal.
Mais ce droit au renouvellement n’est pas aussi direct qu’il n’y paraît : il n’est ni automatique ni absolu.
I. Conditions d’exercice du droit au renouvellement direct du sous-locataire commercial
A. Le sous-locataire doit demander le renouvellement de son bail en priorité auprès du locataire principal
Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail directement au propriétaire seulement si :
- la sous-location est opposable à ce dernier (A),
- le sous-locataire remplit les conditions du droit au renouvellement classique (B),
- la sous-location est soit totale, soit partielle à certaines conditions (C).
Seule une sous-location régulière peut être opposable au bailleur principal.
Or, comme le prévoit l’article L.145-31 du code de commerce, le principe en matière de bail commercial est celui de l’interdiction de la sous-location, sauf exception :
« Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte ».
Ainsi, une sous-location n’est régulière qu’à deux conditions :
- D’une part, si la sous-location est autorisée par le bail ;
- D’autre part, si le bailleur principal a été invité à concourir à l’acte de sous-location.
Ces conditions sont parfaitement distinctes et cumulatives.
Il ne suffit donc pas qu’une sous-location ait par principe été autorisée par le bailleur principal pour qu’elle lui soit opposable.
B. Le sous-locataire doit répondre aux conditions classiques du droit au renouvellement
Tant à l’égard de son bailleur direct ou à l’égard du bailleur principal, le sous-locataire ne peut prétendre au renouvellement de son bail, que si son sous-bail est lui-même soumis au statut des baux commerciaux.
De plus, les conditions spécifiques du droit au renouvellement doivent être respectées (obligation d’être immatriculé au RCS, exploitation effective et personnelle du fonds, etc.).
Et, conformément à l’article L.145-8 du code de commerce, « le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ».
C. La sous-location doit être totale, ou bien partielle sous certaines conditions
L’article L.145-32 al.2 du code de commerce dispose :
« A l’expiration du bail principal, le propriétaire n’est tenu au renouvellement que s’il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l’objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties. »
a) En cas de sous-location totale
Cette condition découle en partie des conditions classiques du droit au renouvellement, évoquées au point B.
En effet, le locataire principal qui a sous-loué la totalité des locaux ne peut, en fin de bail, invoquer aucun droit au renouvellement, puisqu’il n‘exploite plus personnellement un fonds de commerce dans lesdits locaux occupés en totalité par le sous-locataire[1].
Seul le sous-locataire peut revendiquer le droit au renouvellement auprès du propriétaire des lieux, sous réserve du respect des conditions évoquées aux points A et B ci-dessus.
b) En cas de sous-location partielle
En cas de sous-location partielle des locaux, le locataire principal qui exploite un fonds de commerce sur une partie seulement des lieux loués, ne peut demander le renouvellement de son bail que pour la partie des locaux dans laquelle il exerce son commerce, ce qui suppose une absence d’indivisibilité des lieux, matérielle ou conventionnelle[2].
Il en est de même pour le sous-locataire : celui-ci ne pourra exercer un droit au renouvellement de son sous-bail directement auprès du bailleur principal, que sur la partie du local où il exploite son fonds de commerce, et là encore à la condition d’une absence d’invisibilité des lieux, et toujours sous réserve des conditions préalablement évoquées.
En cas d’indivisibilité des lieux, le sous-locataire perd son droit au renouvellement direct auprès du propriétaire : il peut seulement réclamer le renouvellement du sous-bail au locataire principal, mais sans jamais pouvoir envisager devenir locataire principal.
II. Le caractère subsidiaire du droit au renouvellement direct
A. Le sous-locataire doit demander le renouvellement de son bail en priorité auprès du locataire principal
L’article L.145-32 al.1 du code de commerce dispose :
« Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l’acte, comme il est prévu à l’article L. 145-31. ».
Le droit au renouvellement direct ne peut donc naître qu’à l’expiration du bail principal.
L’expiration du bail qui fait naître le droit au renouvellement direct du sous-locataire peut résulter des événements suivants :
- congé avec refus de renouvellement notifié par le propriétaire au locataire principal ;
- congé notifié par le locataire au propriétaire ;
- résiliation du bail principal, qu’elle soit judiciaire ou de plein droit ;
- dénégation du statut au locataire principal, etc.
B. Le droit direct au renouvellement du sous-locataire n’a pas de caractère absolu
Quid du droit au renouvellement direct du sous-locataire lorsque le locataire principal a donné à bail la totalité des locaux loués au propriétaire ?
Dans pareille situation, le locataire principal ne détient plus de droit au renouvellement de son bail.
Il peut s’en déduire que seul le sous-locataire peut prétendre au renouvellement de son bail auprès du propriétaire : le locataire principal, quant à lui, devrait en tout état de cause être évincé, sans pouvoir réclamer aucune indemnité d’éviction, laissant ainsi la place au sous-locataire.
Dans un premier temps, la jurisprudence a consacré cette logique en accordant un caractère absolu au droit direct du sous-locataire au renouvellement, permettant d’évincer le locataire principal à l’expiration du bail principal[3].
Cependant, par un arrêt du 6 décembre 1972[4], la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence en accordant le droit au renouvellement direct qu’« en cas seulement d’insuffisance des droits du locataire principal ».
En d’autres termes, le propriétaire n’est plus obligé de dénier le droit au renouvellement du locataire principal qui ne respecterait pas les conditions classiques du droit au renouvellement (situation « d’insuffisance des droits ») ; c’est par exemple la situation du locataire principal qui n’exploiterait plus de fonds de commerce dans les lieux loués : le propriétaire peut faire bénéficier le locataire principal d’un renouvellement que la loi ne lui permet pas d’exiger[5] (il sera notamment amené à le faire si le loyer principal est supérieur au sous-loyer).
Dans pareille situation, le sous-locataire n’a alors pas d’autre choix que de demander le renouvellement de son sous-bail au locataire principal, lequel doit alors lui donner satisfaction[6], ou bien payer l’indemnité d’éviction.
Et, en cas de prolongation tacite du bail principal, c’est-à-dire en dehors d’un renouvellement, le sous-locataire doit prendre la précaution, afin de conserver ses droits, de solliciter le renouvellement de son sous-bail auprès du locataire principal, quand bien même celui-ci n’aurait plus de droit au renouvellement de son propre bail !
Bernard RINEAU, Avocat associé
Charlotte QUILLIER, Avocat
[1] Cass. 3e civ., 29 octobre 1985, Bull. civ. III n°135 ; Cass. 3e civ., 8 octobre 1986 ; CA Paris, pôle 5, 3e chambre, 2 mai 2012, n°10/21283
[2] Cass. Com. 30 nov. 1959 : JCP G 1960, II, 11440
[3] Cass. Com., 23 octobre 1962, Bull. civ. III, n°417
[4] Cass. Com., 6 décembre 1972, Bull. Civ. III n°664
[5] Cass. 3e civ., 29 mars 1984 : Bull. Civ. III, n°71
[6] Cass. 3e civ., 7 décembre 1977, Bull. Civ. III, n°432