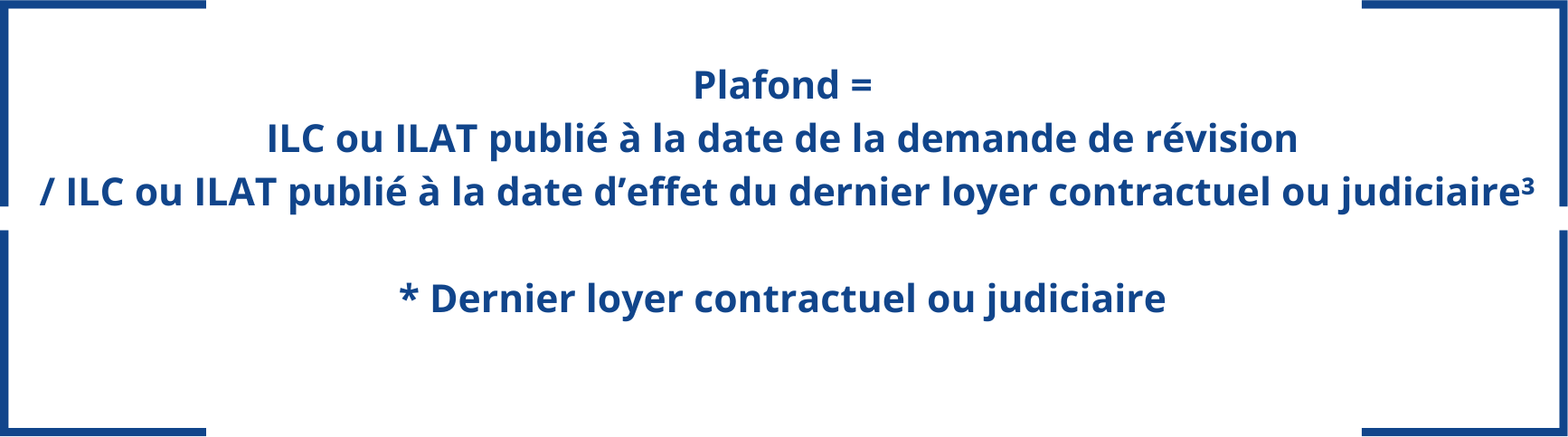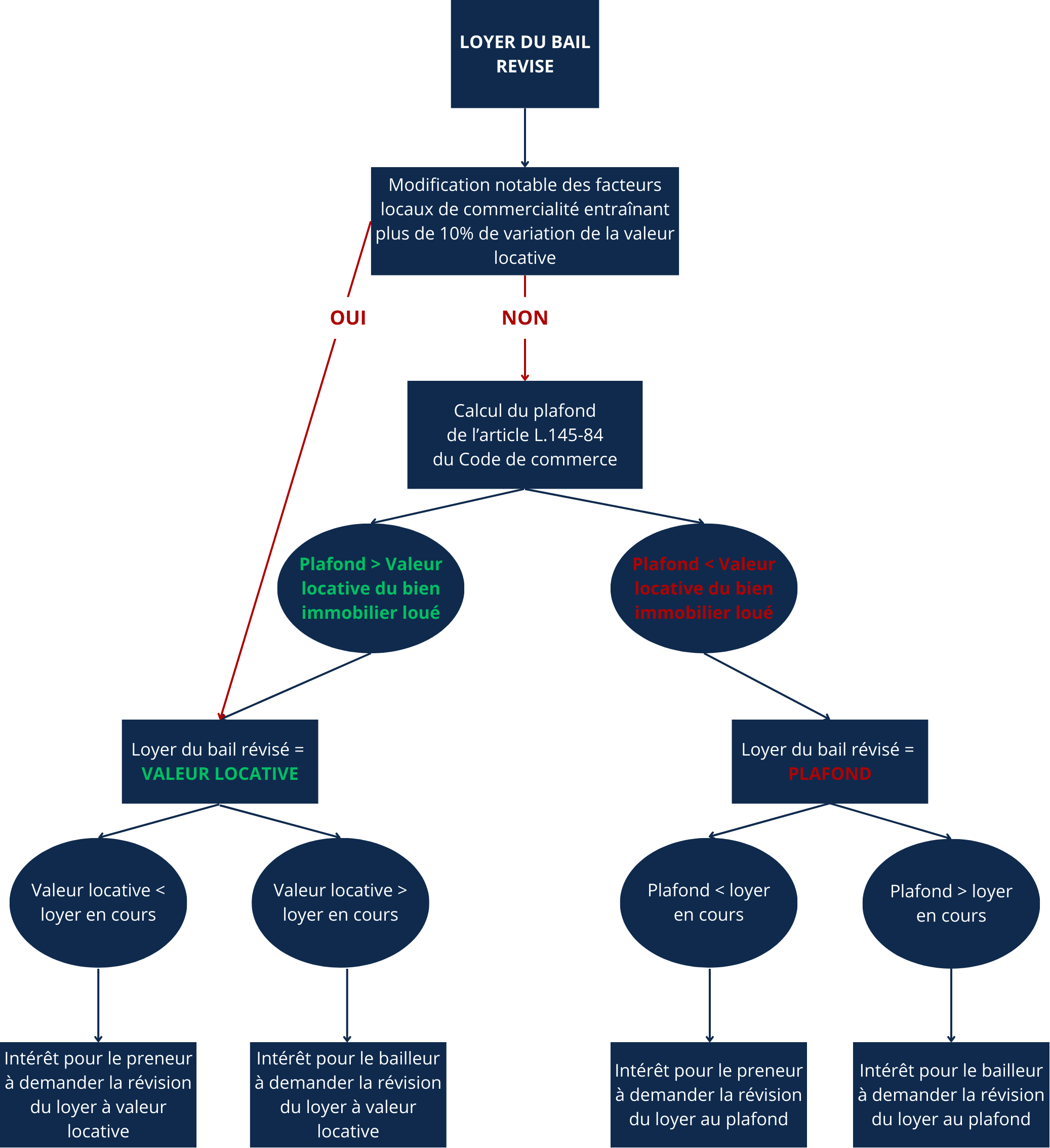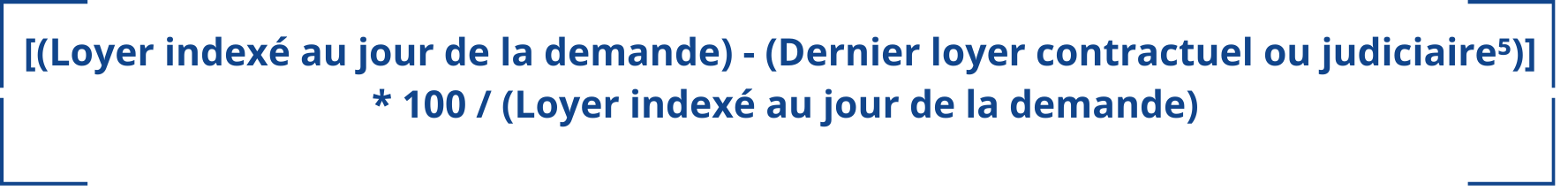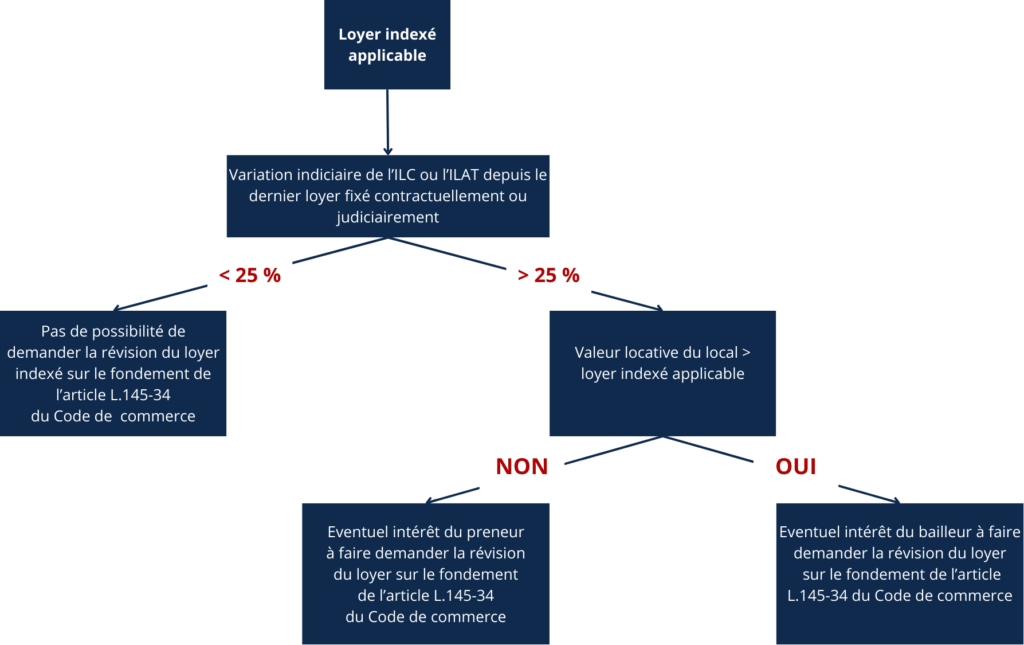1. La preuve, une garantie judiciaire incontournable
Dès le XVIème siècle, le philosophe anglais Francis BACON avait déjà relevé la place centrale de la preuve comme garantie de l’équilibre démocratique d’une société moderne.
L’impératif de la preuve constitue en effet une protection des individus contre l’arbitraire, en ce qu’il est censé interdire toute décision fondée sur d’autres motifs que la vérité et la raison.
La nécessité de prouver ses dires en justice est aujourd’hui inscrite au cœur même de notre système judiciaire et s’affiche dans le Code de Procédure Civile comme l’un des principes directeurs du procès (Article 9 du Code de Procédure Civile).
La sacralisation de l’impératif de la preuve peut parfois conduire à certaines frustrations légitimes, notamment lorsque le justiciable, pourtant certain du bien-fondé de ses dires, se trouve dans l’incapacité matérielle de démontrer leur exactitude ; il s’agit du prix à payer pour garantir l’objectivité du procès.
2. Le régime juridique de la preuve, un régime nuancé
Impératif nécessaire à garantir le succès des prétentions du justiciable, le régime de l’administration de preuve n’est pas un monolithe.
Compte tenu de son caractère infamant et aliénant, la procédure pénale accorde aux personnes mises en cause une liberté totale de la preuve, sans restriction.
En revanche, la procédure civile a, quant à elle, entendu prohiber toute manœuvre illicite ou déloyale de la partie chargée de l’apporter.
Depuis deux arrêts rendus par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 7 janvier 2011 (n°09-14.316 et 09-14.667), le principe de loyauté de la preuve est considéré comme un principe général du droit : à l’occasion de ces deux décisions, la Cour de Cassation a étendu l’interdiction faite aux parties de communiquer des enregistrements de propos obtenus à l’insu de leur auteur.
La liberté de la preuve peut donc être restreinte lorsqu’elle implique la remise en cause de principes fondamentaux : au-delà du principe de loyauté, on peut citer par exemple le secret des affaires, le secret professionnel, ou le droit au respect de la vie privée.
Dès lors, arbitre du régime de la preuve, le juge doit apprécier la légitimité des moyens de preuve qui lui sont présentés et, le cas échéant, écarter les éléments qu’il considère illicites ou déloyaux.
3. La preuve en droit du travail, évolutions
Tel est particulièrement le cas en droit du travail, pour lequel la jurisprudence a alimenté, de manière significative, la délimitation des contours du régime relatif à la loyauté de la preuve.
Durant une trentaine d’années (décennies 1990 – 2000 – 2010), le droit du travail a été particulièrement rigide en prohibant, d’une manière générale et absolue, la production par les parties d’éléments de preuve contraires à ces principes (a, b, c et d.).
Depuis quelques années, on observe un assouplissement jurisprudentiel notoire : le principe de proportionnalité, et la notion de nécessité, conduisent, à présent à admettre la communication d’éléments qui auraient été autrefois rejetés en bloc par le juge (e.).
a) La liberté de la preuve en droit du travail : une liberté encadrée
En droit du travail, de prime abord, la jurisprudence a consacré le principe de la liberté de la preuve, laissant au juge le soin d’apprécier la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis par les parties (Cass, Soc. 27 mars 2001, n°98-44.666).
Néanmoins, à compter du début des années 90, la Cour de Cassation a commencé à limiter cette liberté en posant comme principe général et absolu, l’impossibilité pour les parties de fournir des preuves obtenues de manière illicite ou déloyale (Cass, Soc. 20 novembre 1991, n°88-43.120).
Cette limitation du droit de la preuve s’est surtout fondée sur trois aspects :
- le respect des libertés fondamentales du salarié, notamment le droit au respect de sa vie privée ;
- l’information préalable donnée au salarié quant aux moyens de surveillance dont il peut être l’objet ;
- la prohibition des stratagèmes mis en œuvre par l’employeur dans le cadre de l’exercice de ses moyens de contrôle.
b) Le droit au respect de la vie privée du salarié
Rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 2 octobre 2001, l’arrêt NIKON a instauré le droit du salarié à bénéficier, sur son lieu de travail, au respect de sa vie privée et au secret de ses correspondances.
Ainsi, l’employeur s’est vu interdire de consulter et d’utiliser, contre le salarié, des documents identifiés comme étant personnels, même lorsque ces derniers étaient présents sur le matériel informatique appartenant à l’entreprise (Cass, Soc. 2 octobre 2001, n°99-42.942).
Dans le prolongement de cette jurisprudence, la Cour de Cassation a élargi le droit au respect de la vie privée à la sphère des courriels issus de la messagerie professionnelle dès lors qu’ils étaient, eux aussi, identifiés comme personnels (Cass, Soc. 18 octobre 2011, n°10-26.782).
Naturellement, ce principe a été appliqué lorsque les éléments de preuve émanaient de la messagerie personnelle du salarié (Cass, Soc. 7 avril 2016, n°14-27.949).
L’instauration de cette application du droit au respect de la vie privée du salarié a eu pour conséquence de limiter les capacités d’action de l’employeur, lorsque la preuve de faits fautifs provenait d’éléments de nature personnelle.
A la fin des années 2000, le développement des réseaux sociaux et des messageries instantanées personnelles a fait naître un questionnement sur la possibilité pour l’employeur de sanctionner les propos tenus par les salariés, sur ces supports, contre l’entreprise.
Longtemps, il a ainsi été impossible d’agir contre des salariés injuriant ou calomniant leur employeur, sur des groupes privés restreints.
Dans cette perspective, la Cour de Cassation a considéré que les preuves obtenues au moyen d’une capture d’écran d’une discussion se tenant dans un groupe Facebook privé n’étaient pas recevables, quand bien même la discussion était accessible à… 14 personnes (Cass, Soc. 12 septembre 2018, n°16-11.690).
En cas de transposition à tout support privé, cette position ne pouvait que mettre à mal le pouvoir disciplinaire de l’employeur, lequel risquait de voir son autorité être décrédibilisée impunément par ses salariés.
On verra plus loin que les lignes ont ensuite bougé.
c) Loyauté vis-à-vis du salarié
Au-delà de l’obligation faite aux parties, et notamment à l’employeur, d’apporter des éléments de preuve n’entrant pas en contradiction avec le droit au respect de la vie privée, la jurisprudence a également imposé que la preuve communiquée ait été obtenue loyalement.
L’application concrète de ce principe s’est d’abord traduite par l’obligation faite à l’employeur de ne pas utiliser des preuves obtenues par l’intermédiaire d’un moyen de contrôle dont le salarié n’a pas eu connaissance préalablement.
Cette obligation est clairement posée au sein même du Code du travail, dans son article L.1222-4.
Cela implique, notamment, qu’aucun moyen de vidéosurveillance secret ne puisse être utilisé contre le salarié (Cass, Soc. 7 juin 2006, n°04-43.866).
Il en est de même des moyens de contrôle informatiques secrets (trackers, mouchards installés sur les ordinateurs professionnels, etc…).
La jurisprudence est même allée plus loin, en conditionnant la recevabilité des preuves recueillies par ces méthodes de contrôle à la vérification de la présence d’une consultation préalable des institutions représentatives du personnel avant la mise en service de la méthode (Cass, Soc. 11 décembre 2019, n°18-11.792).
Là encore, la Cour de Cassation entend sanctionner la violation d’une obligation prévue par le Code du travail (Article L.2312-38 du Code du travail).
L’employeur doit procéder à une double information, individuelle et collective, s’il souhaite utiliser les preuves recueillies.
Ce régime informatif diminue l’intérêt de ces moyens de surveillance là où les dispositifs non révélés permettraient, en règle générale, de démontrer un certain nombre de manquements commis par les salariés, notamment les faits de vol.
Pour autant, il parait difficile, sinon impossible, de retenir une autre solution, sauf à s’abandonner à un système intrusif dont on perçoit les prolongements néfastes à la préservation d’une certaine qualité de relation humaine.
d) Les moyens licites de la preuve
La loyauté de la preuve implique également que celle-ci ne soit pas obtenue par l’intermédiaire d’un stratagème.
La Cour de Cassation a rejeté les preuves obtenues par l’intermédiaire de tierces personnes, mandatées par l’employeur, qui s’étaient rendues dans les locaux d’une entreprise en s’étant présentées aux salariés contrôlés, de manière mensongère, comme des agents EDF, pour constater leurs manquements (Cass, Soc. 18 mars 2008, n°06-45.093).
De plus, la Haute juridiction a également censuré le licenciement d’un salarié de la Poste accusé d’avoir ouvert frauduleusement des courriers, la preuve de ce manquement ayant été obtenue par l’intermédiaire de lettres piégées délivrant une encre bleue à leur ouverture (Cass, Soc. 4 juillet 2012, n°11-30.266).
La notion de stratagème englobe aussi les preuves obtenues par l’intermédiaire de l’intervention d’une profession réglementée, comme celle d’un détective privé (Cass, Soc. 26 novembre 2002, n°00-42.401).
Enfin, il est strictement interdit à l’employeur de piéger son salarié en provoquant la commission d’une faute disciplinaire, par incitation : dans ce cas de figure, et même si la preuve des faits est récoltée par un huissier de justice, celle-ci ne sera pas considérée comme recevable (Cass, Soc. 16 janvier 1991, n°89-41.052).
La jurisprudence a ainsi entendu « moraliser » le droit de la preuve appliqué au droit du travail : mais ceci a influé sur l’efficacité du pouvoir disciplinaire de l’employeur, du fait de la limitation des possibilités pour l’entreprise de se prémunir contre les manquements de ses salariés.
Et cette louable préoccupation d’une hiérarchisation s’est également accompagnée d’un hiatus : la réciprocité n’a jamais été de mise. Si le salarié peut, par exemple, communiquer des éléments de preuve obtenus à l‘insu de son employeur, en subtilisant des documents appartenant à celui-ci (dès lors toutefois que cette utilisation est strictement cantonnée à l’exercice de ses droits de la défense – Cass, Soc. 31 mars 2015, n°13-24.410), ces procédés sont exclus du côté de l’employeur.
Néanmoins, au fil des années, on constate que cette rigidité jurisprudentielle a tendance à s’atténuer sous l’égide de la reconnaissance des droits de la défense de l’employeur, et plus généralement, de son droit de jouir des dispositions relatives au procès équitable.
e) L’élargissement progressif de la liberté de la preuve en droit du travail : l’exercice légitime des droits de la défense de l’employeur, versus le droit au respect de la vie privée du salarié
Au nom de la liberté d’agir en justice et/ou au respect des droits de la défense, prévus à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, au fil des années, la Cour de Cassation est venue progressivement limiter les restrictions apportées autrefois au droit de la preuve.
Cette libéralisation du droit de la preuve s’est réalisée dans le prolongement de plusieurs décisions rendues par la Cour Européenne des Droits de l’Homme consacrant le droit de l’employeur à bénéficier d’un procès équitable, même en présence d’une violation par celui-ci des règles étatiques internes relatives à la légalité et à la loyauté de la preuve (CEDH, 17 octobre 2019, LOPEZ RIBALDA, n°1874/13).
Ainsi, dans certains cas, le droit au respect de la vie privée du salarié a été écarté, à condition toutefois que l’atteinte portée soit jugée indispensable à l’exercice des droits de la défense de l’employeur, et proportionnée au but recherché (Cass, Soc. 30 septembre 2020, n°19-12.058).
Cette position s’inscrit d’ailleurs dans la droite ligne de l’article L.1121-1 du Code du travail, lequel autorise, par principe, les atteintes portées aux libertés du salarié lorsqu’une raison objective et impérieuse le justifie.
La Cour de Cassation a donc révisé sa jurisprudence, et validé par exemple la recevabilité d’un constat d’huissier pourtant dressé à l’insu du salarié, démontrant que celui-ci avait violé sa clause de non-concurrence.
Au-delà du fait que le constat avait été réalisé par un professionnel assermenté, dans un lieu public, la haute juridiction a considéré que l’atteinte à la vie privée était proportionnée au but recherché, à savoir l’établissement de l’activité concurrentielle nuisible à l’entreprise (Cass, Civ. 2ème, 14 novembre 2019, n°18-22.008).
Au cours de l’année 2021, dans le même esprit, et pour la première fois, la Cour de Cassation a jugé que l’employeur pouvait utiliser, exceptionnellement, un enregistrement provenant d’une vidéosurveillance non connue des salariés, et non soumise à la consultation des élus du personnel (Cass, Soc. 10 novembre 2021, n°20-12.263).
En 2023, plusieurs décisions rendues par la Cour de Cassation sont venues confirmer ce mouvement de libéralisation du droit de la preuve en droit du travail, en accueillant des preuves de manquements du salarié pourtant uniquement présentes sur un support strictement privé, et de nature confidentielle.
Dans une première affaire, des salariés travaillant dans un service médical d’urgence avaient pris pour mauvaise habitude d’organiser, sur leur lieu et sur leur temps de travail, des soirées très alcoolisées, sans l’accord de leur employeur.
En dehors de la possibilité de prendre les salariés sur le fait, se posait alors la question de savoir quels moyens étaient offerts à l’employeur pour démontrer, devant une juridiction, la réalité des manquements de ces salariés fêtards.
A cette fin, l’employeur ne pouvait compter que sur les captures d’écran d’une messagerie privée, lesquelles avaient été communiquées anonymement à celui-ci par un autre salarié.
La Cour de Cassation a estimé que le caractère privé des échanges ne faisait pas obstacle à leur communication en justice, dès lors que cette production était indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but recherché, notamment à la nécessaire protection des patients (Cass, Soc. 4 octobre 2023, n°21-25.452).
En 2020, cette même logique avait déjà permis à un employeur de communiquer en justice le contenu du profil Facebook privé d’un de ses salariés, dont il avait eu connaissance par un collègue, ami du protagoniste sur le réseau social (Cass, Soc. 30 septembre 2020, n°19-12.058).
Dans ce domaine, les réseaux sociaux et messageries privées ne sont donc plus véritablement protégés.
En revanche, il paraît certain que ces méthodes probatoires n’auraient pas été validées si l’employeur avait pu disposer d’autres moyens de démontrer les manquements des salariés.
Ce constat est d’ailleurs assumé par la Haute juridiction, qui a précisé, dans le cadre d’une autre affaire récente, l’obligation faite à l’employeur de tenter de trouver un résultat identique, en matière de preuve, « en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié » (Cass, Soc. 8 mars 2023, n°21-20.798).
Enfin, tout récemment, l’Assemblé Plénière de la Cour de Cassation a confirmé cette position en généralisant les jurisprudences de la Chambre Sociale concernant cette possibilité de produire des preuves obtenues de manière déloyale, à l’ensemble du procès civil (Cass, Ass Plén. 22 décembre 2023, n°20-20.648).
A noter que cette décision concerne une nouvelle fois le droit du travail et plus particulièrement l’utilisation par l’employeur d’un enregistrement clandestin.
On retiendra que cet assouplissement jurisprudentiel comporte deux limites : la démonstration d’une nécessité avérée pour l’exercice des droits de la défense de l’employeur, et le respect du critère de proportionnalité.
En matière de preuve, la fin ne justifie donc pas toujours les moyens : l’atteinte au principe du droit au respect de la vie privée n’est ainsi acceptée que lorsqu’elle constitue la seule solution offerte à l’employeur pour faire valoir ses droits.
4. Et en droit pénal ?
La violation du droit à la vie privée est théoriquement constitutive d’une infraction pénale prévue et réprimée par l’article 226-1 du Code pénal.
Ainsi, un salarié qui se permettait d’enregistrer son employeur à son insu, afin d’étayer un contentieux prud’homal, s’exposait à être jugé par un Tribunal Correctionnel sur le fondement de cette infraction.
La Cour de Cassation a mis un terme à cette jurisprudence lorsque le salarié enregistrait l’entretien préalable au licenciement sur son téléphone, cet enregistrement ne pouvait être pénalement réprimé, celui-ci ayant été réalisé dans le cadre d’un événement considéré désormais comme étant de nature professionnelle (Cass, Crim. 12 avril 2023, n°22-83.581).
Au-delà de cette immunité, et sur le fondement des jurisprudences récentes rendues en matière sociale, il est envisageable que l’enregistrement d’une discussion professionnelle avec l’employeur puisse désormais être communiqué dans le cadre d’un litige civil devant le Conseil de Prud’hommes, dès lors toutefois que le salarié ne dispose pas d’autres moyens de démontrer le bien-fondé de ses prétentions.
Saisie de cette question, la Cour d’Appel de PARIS avait d’ailleurs déjà tranché en ce sens, avant que l’Assemblée Plénière ne statue sur cette question, au mois de décembre dernier (CA PARIS, 18 janvier 2023, RG 21/04506).
Cette communication peut alors être particulièrement utile, notamment lorsque l’employeur reconnait, oralement, que les motifs d’un licenciement sont en réalité dénués de fondement.
5. Conclusion
L’assouplissement du droit de la preuve est une évolution louable : elle limite aujourd’hui ce trop grand nombre d’affaires qui, par le passé, ne pouvaient pas aboutir à une solution juste, à défaut pour les parties concernées d’avoir pu produire des éléments convaincants…dont elles disposaient pourtant.
Cependant, cette évolution du droit de la preuve s’accompagne d’un corolaire regrettable, en ce qu’elle invite quelque part à piéger un interlocuteur, induisant mécaniquement de possibles faux-semblants, des jeux de rôles, et autres procédés empreints de duplicité.
En outre, la pratique des enregistrements « discrets » conservera toujours une tonalité déloyale, et l’on peut craindre qu’in fine, lorsque cette évolution aura bien été intégrée au monde de l’entreprise, la sincérité, la transparence – voire même la spontanéité des échanges, en pâtisse sérieusement.
Quoi qu’il en soit, dans le cadre de l’établissement d’une stratégie de défense, il est vivement conseillé d’être assisté d’un professionnel du droit capable d’estimer, au regard du contexte du dossier, l’opportunité, ou non, de communiquer certaines preuves.
A ce titre, l’intervention de l’avocat, en amont de l’amorce de la procédure de licenciement, peut être un atout non négligeable pour s’assurer de la validité de celles-ci dans le cadre d’un éventuel contentieux.
Bernard RINEAU
Avocat associé
Kévin CHARRIER
Avocat